La Suisse s’est fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Elle compte atteindre cet objectif en appliquant une stratégie énergétique adaptée. Des investissements dans la production d’énergie renouvelable sont nécessaires pour la réduction des émissions de CO2 et l’émergence des voitures électriques ou pompes à chaleur qui en résulte. Ces mesures affectent toutes la manière dont et le lieu où l’électricité passe dans le réseau électrique. Le réseau de distribution, c’est-à-dire le réseau moyenne et basse tension local (niveaux de réseau 5-7), est particulièrement sollicité ici. La transition énergétique a pour conséquence le fait que l’électricité n’est plus seulement transportée comme avant depuis les centrales électriques jusqu’aux consommateurs et consommatrices, mais qu’elle circule aussi dans l’autre sens. Par exemple lorsqu’une installation photovoltaïque injecte son courant excédentaire dans le réseau. Le réseau de distribution doit donc être suffisamment résistant pour assurer le transport dans les deux directions. Mais l’extension nécessaire à cet effet s’accompagne de difficultés administratives, coûteuses et chronophages qui freinent la transition énergétique.
La procédure d’autorisation pour l’extension de l’infrastructure réseau est extrêmement longue
À l’automne 2022, le Parlement fédéral a adopté l’Offensive solaire. Désormais, la bureaucratie devrait être allégée pour les autorisations relatives aux installations solaires alpines. La construction d’une installation solaire alpine comporte trois objets: les panneaux solaires, la ligne de raccordement pour l’installation photovoltaïque et le renforcement du réseau. C’est le propriétaire qui est responsable du projet pour les panneaux solaires et leur ligne de raccordement. L’installation solaire est approuvée par le canton, tandis que la ligne de raccordement est autorisée par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) au niveau fédéral. Ces deux procédures ont été accélérées avec l’Offensive solaire. Toutefois, pour que le courant produit puisse être injecté dans le réseau électrique et distribué aux consommatrices et consommateurs, il est généralement aussi nécessaire de renforcer le réseau. La responsabilité incombe ici au gestionnaire du réseau de distribution, comme BKW. Le renforcement est également approuvé par l’ESTI, mais pas dans le cadre de la procédure accélérée. Par conséquent, les installations ont beau pouvoir être construites rapidement, l’électricité n’arrive pas chez les consommatrices et consommateurs car le réseau de distribution ne peut pas être renforcé assez rapidement.
Par ailleurs, la construction d’une installation photovoltaïque alpine exige trois procédures d’autorisation différentes, à divers niveaux de l’État (Confédération et canton), bien qu’il s’agisse du même état de fait tant au niveau technique que géographique (voir graphique 1).
Bilan n° 1: quand on pense à la transition énergétique, il faut également toujours penser au réseau électrique. Outre les installations solaires alpines et leurs lignes de raccordement, le renforcement nécessaire du réseau de distribution doit également pouvoir bénéficier de la procédure accélérée. Le réseau électrique et les installations de production doivent être considérés et traités comme un système global.
L’extension du réseau implique d’immenses contraintes bureaucratiques
La charge administrative, qui a évolué au fil du temps, est un autre facteur qui fait traîner en longueur la procédure d’autorisation. Un exemple: un projet d’extension de ligne électrique de BKW nécessitait la construction d’un forage de 250 mètres de long, ainsi que d’un puits de départ et d’arrivée de deux mètres sur trois chacun. Dans le cadre de la procédure correspondante de l’ESTI, un total de cinq instances et neuf départements différents ont été invités à prendre position. Toutes ces instances ont donc dû traiter un projet relativement petit, qui n’a eu qu’un impact minimal et uniquement temporaire sur le paysage. En parallèle, il est très coûteux et long de faire intervenir autant d’instances. La complexité de la législation représente donc un frein à une transition énergétique rapide.
Bilan n° 2: la transition énergétique nécessite des procédures d’autorisation simples et judicieuses pour pouvoir atteindre les objectifs fixés dans des délais raisonnables.
Les mesures de construction nécessaires à l’extension du réseau doivent être encouragées
L’extension du réseau de distribution n’implique pas seulement de tirer des câbles plus épais jusqu’aux différentes maisons, mais aussi de mettre en place de nouvelles stations transformatrices, par exemple, car le renforcement du réseau basse tension ne suffit pas dans certains endroits (graphique 2). Toutefois, cela n’est pas possible partout. Par exemple:
dans un village, une ancienne station à deux pylônes doit être remplacée par une station compacte car elle est devenue trop vieille. En raison du manque d’espace, BKW a donc cherché un autre emplacement adapté. Il s’agit d’une activité compliquée. En effet, il est interdit de construire des stations transformatrices qui alimentent une zone à bâtir en dehors de la zone à bâtir. En d’autres termes, le gestionnaire du réseau de distribution a besoin de la coopération des propriétaires privés pour pouvoir mettre en place une station transformatrice sur leur terrain à bâtir. Si cela n’est pas possible, le gestionnaire du réseau de distribution n’a pas d’autre choix que de rechercher des alternatives plus coûteuses – dans ce cas, à plusieurs dizaines de milliers de francs. L’option de dernier recours, une procédure d’expropriation, n’est généralement pas indiquée, car elle risque de provoquer des retards considérables. Dans cet exemple, un retard aurait pour conséquence d’empêcher la construction de nouvelles installations solaires dans tout le quartier, mettant ainsi en péril les objectifs de la transition énergétique (graphique 3). De manière générale, il faut s’attendre à ce que la recherche d’emplacements pour de nouvelles stations ou de nouveaux tracés de ligne devienne encore plus difficile à l’avenir. En effet, la solution de l’expropriation n’est généralement pas envisageable en raison de la perception négative et de la résistance compréhensible des propriétaires fonciers.
Bilan n° 3: pour accélérer au maximum la transition énergétique, il faut des conditions-cadres réglementaires coopératives et judicieuses.
La transition énergétique réussira à condition d’intégrer le réseau de distribution
La procédure d’autorisation toujours aussi lente, les fortes contraintes bureaucratiques et les conditions-cadres de l’aménagement du territoire pour le réseau de distribution soulignent clairement une chose: le réseau de distribution pourrait devenir l’embouteillage de la transition énergétique. Il est donc impératif de tenir compte du réseau de distribution dans la mise en œuvre des mesures visant à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050. Seul un réseau de distribution puissant et stable peut répartir l’électricité issue d’énergies renouvelables.
Un projet de loi pour accélérer les réseaux électriques doit regrouper tous les niveaux de réseau
Le Conseil fédéral prévoit également de présenter au Parlement un projet d’accélération correspondant dans le domaine des réseaux. BKW salue cette initiative, car l’extension du réseau moyenne et basse tension notamment menace de devenir l’embouteillage de la transition énergétique. En effet, le réseau de distribution constitue la ligne directe vers la transition énergétique: plus de 90% de toutes les installations solaires, toutes les bornes de recharge pour l’électromobilité (hors camions) et toutes les pompes à chaleur sont raccordées aux deux niveaux de réseau inférieurs. La transition énergétique se passe donc principalement dans le réseau basse et moyenne tension. L’accélération du réseau doit donc tenir compte de tous les niveaux de réseau.
BKW approuve l’orientation du décret d’accélération
Le projet comprend des éléments judicieux. La Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national (CEATE-N) a également procédé à des ajustements bienvenus, comme le fait de permettre au responsable de projet de décider s’il préfère la procédure cantonale d’approbation du projet pour l’autorisation de son installation photovoltaïque ou éolienne, ou la procédure ordinaire de planification et de permis de construire.
BKW voit toutefois un point négatif dans la proposition de minorité qui souhaite exclure l’énergie éolienne de la procédure accélérée. L’énergie éolienne est un élément essentiel du mix énergétique suisse. En outre, un parc éolien fournit de l’électricité quand d’autres sources renouvelables en produisent moins, à savoir en hiver.
Une autre proposition de minorité requiert quant à elle de limiter le droit de recours contre les projets d’intérêt national aux organisations comptant plus de 50’000 membres. De nombreux exemples montrent que les options de recours sont notamment utilisées par de très petites associations sans présence locale, ce qui fait traîner certains projets en longueur pendant des années. Une modification de la loi en ce sens pourrait permettre aux responsables de projets et aux associations de protection de trouver des compromis plus facilement. Dans le même temps, le droit d’opposition doit être garanti, notamment aux grosses associations de défense de l’environnement, car un bon équilibre entre protection et utilité reste important.










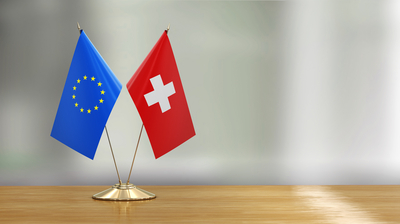
Commentaires
BKW est ouverte à un dialogue en ligne respectueux (notre nétiquette) et accueillera volontiers vos commentaires et vos questions. Pour les questions qui ne correspondent pas au sujet ci-dessus, veuillez utiliser le formulaire de contact.